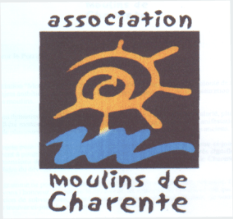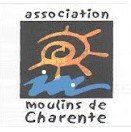Bienvenue à l'association
des Moulins de Charente
Evènements
Journées du patrimoine de pays et des moulins
27-28-29 juin 2025
Actualités
30/11/22 Les moulins, quel potentiel électrique ?
En cette période d’incertitude énergétique, la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins (FFAM) est plus que jamais persuadée de l’intérêt général que représente ce patrimoine, à la fois pour l’écologie de nos rivières et le maintien des eaux indispensable à la vie, mais également comme outil de production d’énergie et de revitalisation de nos territoires.
Arrêtés préfectoraux réglementant la manœuvre des vannes
Pour connaître l'ensemble des arrêtés préfectoraux réglementant la manœuvre des vannes sur les cours d’eau de la Charente
Bref historique :
Les moulins sont connus depuis le 1er siècle avant Jésus Christ. Les principes d'écrasement des grains sont déjà maîtrisés par les meuniers du moyen orient par l'utilisation de la force hydraulique qui met en mouvement des meules de pierre. Ce sont les Romains qui introduisirent le moulin en Gaule occupée.
Au moyen âge cette technique fut graduellement améliorée et étendue à la fabrication d'autres produits alimentaires comme les huiles.
Dés le X eme siècle, avec l'invention de l'arbre à cames, la force hydraulique alliée au savoir-faire moulinier sont appliqués à tous les secteurs de l'artisanat.
Drapiers, papetiers, tanneurs, forgerons, scieurs de pierre et de bois, virent leurs métiers changer de dimension et l'on assista à une véritable révolution des techniques de fabrication.
Jusqu'à la Révolution la plupart des moulins étaient banaux, ils appartenaient aux nobles et aux clairs. Leurs sujets sont tenus de venir y moudre leurs grains moyennant paiement d'un droit.
L'abolition des privilèges et le libéralisme qui s'ensuivit eurent pour conséquence la multiplication des moulins jusqu'à la fin du XIX eme siècle.
Période dense et riche où le meunier a un rôle social très en vue dans le monde rural.
C'est au cours du XI eme siècle que les premiers moulins s'implantèrent sur les rivières charentaises. En 1818 on dénombrait en Charente 867 moulins à eau et plus de 124 moulins à vent, soit un moulin pour 150 à 200 habitants. Ils sont les témoins de l'activité économique et industrielle de notre département.
Le XIX eme siècle fut une période faste que la révolution industrielle, avec l'introduction de la vapeur, vint bouleverser dés les années 1880.
Une invention poussant l'autre, tout se mit à aller très vite, les turbines se substituèrent aux roues en bois, les cylindres aux meules de pierre, les plansichters aux blutoirs de toile.
Beaucoup de moulins ne purent s'adapter et se moderniser faute de moyens financiers suffisants.
En 1935, c'est une loi instituant le contingentement par moulin calculé sur sa capacité d'écrasement qui annonce la fin de la production artisanale. Puis en 1953 la transformation du contingent en « droit de mouture » achève ceux qui avaient survécu à cette mutation.
Aujourd'hui pour sauver les petits moulins, du moins ceux qui n'ont pas été transformés en résidences secondaires, on pense aussitôt au tourisme. Il est vrai que certains devenus musées, écomusées ou encore moulins-auberges ont visiblement réussis une reconversion spectaculaire.
Des amoureux des moulins et de leurs techniques ancestrales investissent ces témoins d'une autre époque, de nouveaux meuniers remettent en mouvement roues, arbres, meules séculaires et ailes pour fabriquer à nouveau farines et huiles.
Il n'en demeure pas moins qu'un autre avenir économique est possible et peut s'imaginer à l'aube de nos nouveaux besoins en énergie propre et renouvelable et surtout de proximité avec la production d'électricité.
Et si nos moulins redevenaient des fabriques à produire d'autres rapports économiques, d'autres rapports sociaux plus solidaires et plus proches des besoins humains.
Jean-Luc FAUTERET.
Moulin de La Gravelle.